


L'apprentissage non supervisé permet d'extraire des motifs cachés dans les données sans étiquettes, ouvrant la voie à de nombreuses applications innovantes.
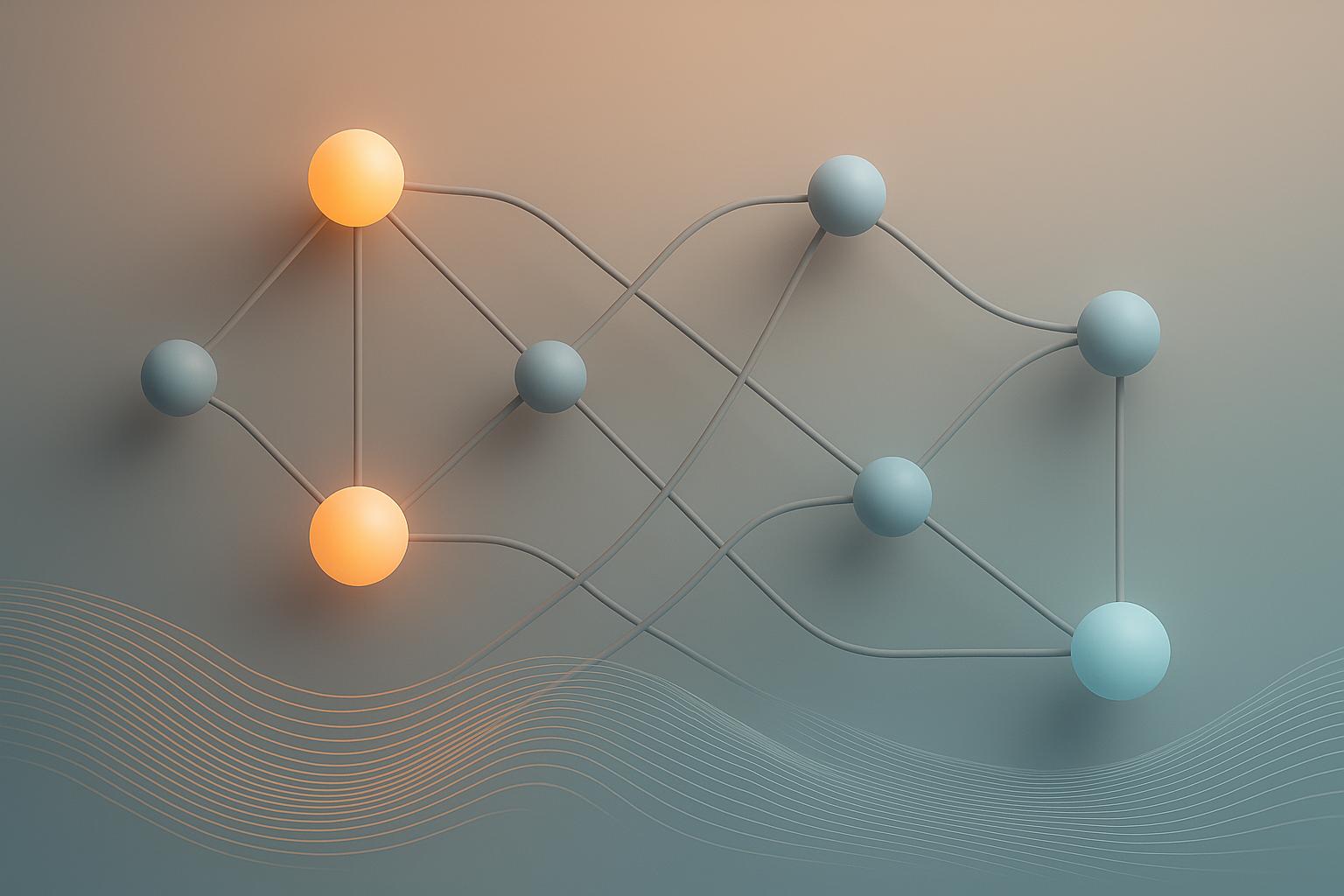
L'apprentissage des caractéristiques non supervisé permet d'extraire automatiquement des motifs et structures dans des données brutes, sans nécessiter d'étiquettes. Contrairement à l'apprentissage supervisé, cette méthode analyse les propriétés intrinsèques des données pour des applications comme le clustering, la réduction de dimensionnalité ou la détection d'anomalies. Voici les points essentiels :
L'apprentissage non supervisé ouvre des possibilités dans de nombreux secteurs, mais demande une préparation rigoureuse et une analyse approfondie des résultats.
L'apprentissage non supervisé permet d'extraire des informations utiles à partir de données brutes, sans nécessiter d'étiquettes préalablement définies. Les algorithmes analysent les données pour identifier des regroupements ou des similitudes, souvent invisibles dans une analyse supervisée. Cette méthode met en lumière des structures sous-jacentes dans les données, offrant une perspective différente et souvent inattendue. Mais pour en tirer le meilleur parti, il est crucial de bien préparer vos données.
La qualité des données joue un rôle clé dans le succès de tout projet. Il est d'ailleurs bien connu que les data scientists passent environ 80 % de leur temps à cette étape.
La première tâche ? Nettoyer les données. Cela implique de corriger les erreurs, gérer les valeurs manquantes, éliminer les doublons et résoudre les incohérences. Pour les valeurs manquantes, plusieurs solutions existent : vous pouvez utiliser la moyenne, la médiane, le mode ou même des techniques plus avancées comme la régression. Si les données manquantes sont peu nombreuses, il est parfois plus simple de supprimer les lignes ou colonnes concernées.
Les doublons, quant à eux, peuvent fausser les résultats et entraîner un surapprentissage.
Ensuite, les données doivent être transformées pour s'adapter à l'analyse. Cela inclut des étapes comme la standardisation, la mise à l'échelle et l'encodage des variables catégorielles. Par exemple, pour des données numériques avec des échelles variées, vous pouvez appliquer une normalisation Min-Max (pour ramener les valeurs entre 0 et 1) ou une standardisation Z-score (moyenne de 0, écart-type de 1). Ces techniques sont particulièrement utiles pour des modèles sensibles à l'échelle, comme les réseaux de neurones ou l'analyse en composantes principales.
En France, il faut aussi tenir compte des spécificités locales. Par exemple, la virgule est utilisée comme séparateur décimal, contrairement au point. Si vous travaillez avec des données contenant des valeurs comme « 1 234 567,9876 », il est conseillé de les traiter d'abord comme du texte. Vous pouvez ensuite utiliser des outils comme le module locale en Python (avec l'option fr_FR.UTF-8) pour convertir ces champs dans un format numérique standard.
Une fois les données prêtes, il est temps de se pencher sur les conditions nécessaires et les défis spécifiques à l'apprentissage non supervisé.
Pour que l'apprentissage non supervisé soit efficace, certaines conditions doivent être réunies. D'abord, il est essentiel de disposer d'un volume de données suffisant. Plus le dataset est grand, plus l'algorithme pourra identifier des motifs solides et représentatifs. À l'inverse, un échantillon trop limité risque de fournir des résultats peu fiables.
Une approche exploratoire est également indispensable. Contrairement à l'apprentissage supervisé, où l'objectif est clairement défini dès le départ, l'apprentissage non supervisé repose sur l'expérimentation. Cela nécessite d'adapter ses hypothèses en fonction des résultats obtenus, tout en restant ouvert à l'inattendu.
Cependant, l'interprétation des résultats peut s'avérer complexe. Les caractéristiques extraites automatiquement par les algorithmes sont souvent difficiles à traduire en termes concrets, ce qui peut poser problème, notamment dans des secteurs où la transparence est cruciale.
Enfin, le fait de ne pas disposer de données étiquetées a ses avantages et ses inconvénients. D'un côté, cela élimine le coût et le temps nécessaires pour annoter manuellement les données. Mais de l'autre, cela complique l'évaluation des résultats, nécessitant des métriques alternatives pour juger de leur pertinence. De plus, comme les algorithmes d'apprentissage non supervisé s'appuient souvent sur des processus aléatoires, il est essentiel de répéter les itérations pour repérer les motifs les plus cohérents et significatifs.

L'apprentissage des caractéristiques non supervisé repose sur trois grandes catégories de méthodes. Comprendre ces approches vous aidera à choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.
Le clustering regroupe des données similaires sans nécessiter de catégories prédéfinies.
K-means est l'un des algorithmes les plus courants. Il divise les données en K groupes distincts, chaque point étant assigné au cluster dont le centroïde est le plus proche. Bien qu'efficace pour des clusters sphériques, il exige de connaître à l'avance le nombre de clusters.
Le clustering hiérarchique crée une hiérarchie de groupes en suivant deux approches : soit en fusionnant progressivement des points similaires (ascendante), soit en divisant un groupe unique en sous-groupes (descendante). Les résultats sont souvent représentés sous forme de dendrogramme, permettant une visualisation claire des relations entre les groupes.
DBSCAN se démarque en identifiant des clusters de formes variées tout en gérant efficacement les valeurs aberrantes. Contrairement à K-means, il ne nécessite pas de spécifier le nombre de clusters, s'appuyant sur la densité des points pour former les groupes.
Les modèles de mélange gaussien adoptent une approche probabiliste, attribuant à chaque point des degrés d'appartenance multiples.
Outre le clustering, des techniques centrées sur la réduction de la complexité des données offrent une autre manière d'exploiter vos informations.
Ces méthodes simplifient les données tout en conservant leur essence, ce qui améliore les performances des algorithmes et facilite leur interprétation.
L'Analyse en Composantes Principales (ACP) est une méthode linéaire qui génère de nouvelles variables non corrélées, appelées composantes principales, capturant un maximum de variance. Elle est idéale pour réduire les redondances dans des ensembles de données volumineux. Par exemple, un jeu de données clients comportant 50 variables peut souvent être résumé en 5 à 10 composantes principales sans perte majeure d'information.
La méthode t-SNE projette des données multidimensionnelles de manière non linéaire tout en préservant les similarités locales. Elle est particulièrement utile pour explorer des structures complexes.
La Décomposition en Valeurs Singulières (SVD) factorise une matrice en trois matrices de rang inférieur, permettant de réduire le bruit et de compresser les données. L'Analyse Factorielle, quant à elle, identifie les facteurs sous-jacents expliquant les corrélations entre variables, regroupant celles qui mesurent des concepts similaires.
Les autoencodeurs, issus des réseaux de neurones, utilisent également l'apprentissage non supervisé pour extraire automatiquement les caractéristiques clés. Ils compressent les données avant de les reconstruire, forçant ainsi l'identification des éléments essentiels. Ce processus permet de détecter des motifs significatifs dans des ensembles de données non étiquetées.
Différentes variantes d'autoencodeurs répondent à des besoins spécifiques. Par exemple, les autoencodeurs variationnels introduisent une dimension probabiliste qui peut générer de nouvelles données similaires à celles d'entraînement. Les autoencodeurs débruitants, quant à eux, apprennent à reconstruire des données propres à partir d'entrées bruitées, ce qui les rend particulièrement robustes face aux perturbations.
Le choix de la méthode dépend de vos objectifs : segmentation de clientèle, visualisation de données complexes ou extraction de caractéristiques avancées. Chacune de ces techniques offre une perspective unique et peut révéler des informations complémentaires sur vos données.
Après avoir abordé la préparation des données, passons à l'application concrète. Ce guide structuré vous aidera à utiliser l'apprentissage des caractéristiques non supervisé sur vos propres données, même si vous n'êtes pas expert en la matière.
Tout commence avec des données bien préparées. La qualité de vos résultats dépend directement de cette étape. Rassemblez un échantillon représentatif de votre activité. Par exemple, pour une boutique en ligne en France, cela pourrait inclure :
Ensuite, nettoyez les données. Supprimez les valeurs manquantes, les doublons et les incohérences (comme des dates de naissance impossibles ou des montants négatifs). Si vos variables utilisent des unités différentes, pensez à les normaliser. Prenons un exemple : si vous analysez l’âge (20–80 ans) et le chiffre d’affaires annuel (500–50 000 €), normalisez ces valeurs entre 0 et 1 pour éviter qu’une variable ne prenne trop de poids par rapport aux autres.
Enfin, respectez les formats français : utilisez des virgules pour les décimales, le format JJ/MM/AAAA pour les dates, et insérez un espace pour séparer les milliers.
Le choix de l’algorithme dépend de vos objectifs. Si vous souhaitez segmenter vos clients et avez une idée du nombre de groupes, K-means est un bon choix. Par exemple, si vous visez à identifier 5 profils de clients distincts, cet algorithme est adapté. Si vous préférez que l’algorithme découvre les groupes de manière autonome, DBSCAN peut être une meilleure option.
Pour réduire la complexité d’un jeu de données avec de nombreuses variables, pensez à l’ACP (Analyse en Composantes Principales). Cette méthode permet de condenser les données en quelques composantes principales qui capturent l’essentiel de la variance.
Si vos données sont plus complexes, comme des images de produits ou des commentaires clients, les autoencodeurs pourraient être plus adaptés. Bien qu’ils demandent plus de puissance de calcul, ils offrent souvent de bons résultats.
Lors de l’entraînement, commencez avec des paramètres prudents. Par exemple, pour K-means, testez plusieurs valeurs de K (entre 3 et 10). Avec l’ACP, examinez combien de variance est expliquée par chaque composante pour déterminer combien en retenir. Une fois le modèle entraîné, évaluez soigneusement sa qualité.
L’évaluation des résultats non supervisés peut être complexe. Comme le souligne Nikolas Rieble :
Assessing the quality of unsupervised machine learning algorithms is problematic since there exists no external criteria (=unsupervised).
Pour mieux comprendre vos résultats, visualisez vos données transformées en 2D ou 3D afin de repérer des motifs cachés.
Dans le cas des méthodes de clustering, examinez la variance entre et au sein des groupes. Si la variance inter-groupes diminue après un nouvel entraînement, cela peut signifier que les groupes ne sont pas bien séparés, ce qui pourrait indiquer un problème avec l’algorithme.
Un autre test consiste à vérifier la cohérence des groupes. Conservez un sous-ensemble d’observations bien classées lors du premier entraînement, relancez le modèle et comparez les résultats. Si les groupes changent, cela mérite une analyse approfondie.
Enfin, évaluez la pertinence des caractéristiques apprises en les utilisant dans une tâche supervisée. Les performances obtenues (comme la précision ou le taux d’erreur) reflètent la qualité des caractéristiques extraites.
En février 2019, Dosovitskiy et son équipe ont proposé une méthode d’apprentissage non supervisé basée sur une augmentation extrême des données pour créer des "classes de substitution". Ils ont testé ces caractéristiques sur le jeu de données STL-10 dans une tâche discriminative supervisée. Selon leurs résultats, les performances de classification se stabilisaient autour de 2 000 classes de substitution et 32 à 64 échantillons par classe, illustrant comment les caractéristiques apprises peuvent être transférées avec succès à des tâches supervisées.
Une fois l'apprentissage non supervisé mis en œuvre, il est essentiel de comprendre comment l'utiliser concrètement et quelles en sont les limites.
L'apprentissage non supervisé trouve des usages variés et impactants dans plusieurs secteurs. Voici quelques exemples :
Malgré ses avantages, l'apprentissage non supervisé présente certaines contraintes :

Pour relever ces défis, il est souvent nécessaire de s'appuyer sur des experts. C'est là que Zetos intervient.
Fondée par trois entrepreneurs ayant une solide expérience dans le numérique, Zetos propose un accompagnement complet pour intégrer efficacement l'apprentissage non supervisé dans vos projets.
L'équipe travaille en étroite collaboration avec des CEO, CTO et fondateurs d'entreprises technologiques, garantissant une compréhension approfondie des enjeux stratégiques et opérationnels. Avec Zetos, vous bénéficiez d'un partenaire qui allie expertise technique et vision business.
Après avoir parcouru les différentes méthodes et leurs applications, voici un résumé des points essentiels : l'apprentissage non supervisé est une approche puissante pour extraire des informations à partir de données brutes, souvent inexploitées.
Ces techniques s’appliquent à une multitude de secteurs : segmentation client, détection de fraudes, systèmes de recommandation ou encore analyse de sentiment sur les réseaux sociaux. Elles permettent de mettre en lumière des structures cachées, souvent synonymes de nouvelles opportunités commerciales.
Cependant, il est important de noter les défis associés, comme l'absence de données étiquetées pour valider les résultats, une interprétation parfois complexe et une sensibilité accrue aux données d’entrée. Ces limites exigent une approche méthodique et des ajustements constants.
Pour tirer le meilleur parti de ces méthodes, commencez par définir clairement vos objectifs. Testez différentes approches sur un échantillon réduit avant d’étendre vos analyses à l’ensemble de vos données. Une bonne préparation des données et des ajustements réguliers des paramètres sont essentiels pour obtenir des résultats fiables.
Besoin d’un coup de pouce ? Zetos est là pour vous accompagner. Leur équipe d’experts en IA peut vous guider à chaque étape, de la conception de prototypes à leur déploiement. Avec une approche itérative et une expertise solide, ils transforment vos idées en solutions concrètes.
Aujourd’hui, l’apprentissage non supervisé n’est plus une simple curiosité technologique. C’est un outil éprouvé qui peut révolutionner la manière dont vous exploitez vos données. Il est temps de passer à l’action et d’intégrer ces techniques pour donner un nouvel élan à vos projets.
L'apprentissage non supervisé présente des atouts importants face à l'apprentissage supervisé. L'un de ses principaux points forts est sa capacité à travailler avec des données non étiquetées. Il permet ainsi de mettre en lumière des structures ou des modèles cachés sans nécessiter de labels définis au préalable. Cela en fait une solution idéale pour explorer des ensembles de données où le marquage manuel serait trop coûteux ou tout simplement irréalisable.
Cette méthode se révèle également très utile pour des tâches spécifiques comme la détection d'anomalies ou l'identification de nouvelles tendances. Elle s'adapte parfaitement à l'analyse de volumes importants de données, souvent en temps réel, tout en contournant les contraintes liées à l'étiquetage manuel, qui peut être long et laborieux.
L'apprentissage non supervisé se distingue donc comme un outil essentiel pour extraire des informations pertinentes à partir de données brutes, tout en simplifiant les étapes de préparation des données.
Pour juger de l'efficacité d'un modèle d'apprentissage non supervisé sans disposer de données étiquetées, vous pouvez vous appuyer sur des métriques de cohérence interne. Parmi celles-ci, l'indice de silhouette et la mesure de cohésion sont particulièrement utiles. Ces outils permettent de vérifier dans quelle mesure les éléments d'un même groupe sont similaires entre eux, tout en étant bien distincts des éléments des autres groupes.
Si votre modèle utilise des probabilités, des approches comme la log-vraisemblance ou la perplexité peuvent également entrer en jeu. Ces mesures évaluent la plausibilité statistique des résultats produits par le modèle. En d'autres termes, elles aident à estimer la qualité des regroupements ou des structures identifiées, même en l'absence de données étiquetées.
L'apprentissage non supervisé peut être incroyablement puissant, mais il ne vient pas sans ses défis. Voici quelques-uns des obstacles les plus courants :
Même face à ces difficultés, il existe des moyens de les contourner et d'optimiser vos analyses :
Avec une démarche structurée et réfléchie, ces défis peuvent se transformer en opportunités pour tirer des enseignements précieux de vos données.